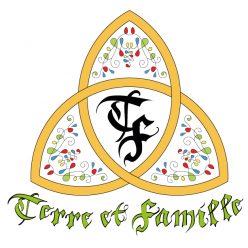Une semaine plus tard, je rencontre notre voisine sur le chemin de l’école.
– Come stai?
Pour toute réponse, elle fond en larmes. Dans son italien encore plus bancal que le mien, elle me demande si nous ne sommes pas fâchés, m’assure que « ce n’est pas personnel », qu’ils souhaitent juste protéger leurs enfants. Comme si nous, nous ne souhaitions pas également le meilleur pour les nôtres. Mais passons. Son émotion me submerge. J’essaie de la tranquilliser, lui demande de ne pas écouter les médias, de ne pas avoir peur. Je lui rappelle les chiffres ridicules des morts de cette « épidémie » dans la région. Sa fille de cinq ans, respirant tant bien que mal sous son masque en tissu, retrouve enfin mon fils. Ils semblent contents de se voir, sur ce petit bout de trottoir. Mais la rencontre est de courte durée. Notre voisine s’apprête à la garder enfermée chez elle une semaine de plus, pour respecter le « délai de contagion ». Elle découvrira même bientôt que passé 5 jours d’absence, la gamine devra subir un examen médical pour garantir qu’elle est assez saine pour retourner à l’école. C’est sans fin. Quoi qu’il en soit, les larmes coulent, ma voisine est à bout de nerfs. Je commets alors un crime éhonté : je la prends dans mes bras et l’embrasse sur la joue. Je lui répète de ne pas avoir peur. Elle s’en va. Elle doit récupérer le grand à l’école. Ce dernier a eu la chance de ne pas avoir eu de parents d’élèves « en contact avec un cas positif ». Du moins ses parents l’espèrent-ils. Je poursuis mon chemin avec les enfants. Mon fils me demande pourquoi la petite voisine ne va pas à l’école. Pourquoi, en effet? Je lui dis que ses parents ont peur de la maladie. Il répond qu’il est amoureux d’elle. Nous marchons. J’essaie de changer de sujet.
Chamboulée moi aussi par tout cela, je m’arrête devant le café qui jouxte notre immeuble. Ce café est tenu par un jeune couple de lesbiennes. L’une est restée féminine, l’autre est un vrai petit camionneur. Elles ont investi toutes leurs économies, ont fait un emprunt pour pouvoir développer leur propre affaire et ne plus avoir à travailler, comme elles le faisaient jusque-là, dans un supermarché sans âme (pléonasme). Bien mal leur en a pris! Je m’inquiète pour elles, je décide de leur parler. Je n’ai jamais eu avec elles que des échanges superficiels. Il est temps que ça change.
– Come state?
C’est la plus féminine qui est sur le pas de la porte. Elle se tourne vers moi, les yeux pleins de larmes. La fatigue, le découragement, l’inquiétude, le désarroi se lisent sur son visage. Elle s’appelle Giada – Jade, et ses yeux ont effectivement cette couleur. Nous nous parlons de coeur à coeur, le masque sur le menton. Elle me raconte son désespoir, ne comprenant pas la peur des autres commerçants de la ville qui souhaitent obéir au décret exigeant la fermeture des bars et restaurants à 18h.
– Si nous sommes les seules à rester ouvertes, les flics nous mettront une amende. Que faire? Mais de quoi ont-ils peur?
De quoi ont-ils peur? De la force. De la force injuste des bras armés qui nous gouvernent. Des larmes tremblotent à la lisière de ses cils. Son khôl s’échappe. Je lui laisse mon numéro de téléphone – s’il y a une manifestation, ou quelque chose, qu’elles me tiennent au courant. Je rentre chez moi avec les enfants qui innocemment me font voir leurs derniers desseins.
Deux jours plus tard, c’est moi qui n’en peux plus. Je m’effondre à l’église pendant une messe matinale. Un torrent de colère et d’écoeurement s’échappe de moi. Quand les gens sont partis, je vais trouver ce jeune prêtre que je connais un peu, dans la sacristie. Il comprend que j’ai besoin de parler. Direction le confessionnal. Entre deux sanglots je lui explique que je ne supporte plus ce monde. Ce monde « sans contact » que même l’Église valide en faisant respecter en son sein « la distanciation sociale ». Je lui dis que ces petits signes verts qui indiquent les endroits sur les bancs où l’on a le droit de s’asseoir, aussi loin que possible des autres, que ces masques qui suppriment toute expression et tout échange humain, me révulsent au plus haut point. Sans parler des messes vides célébrées par le Pape lui-même. Je lui demande s’il comprends que c’est là une structure de péché qui est en train de s’installer, dans la Cité et dans l’Église, et pas n’importe quel péché puisqu’il s’agit ni plus ni moins du rejet de l’Incarnation. Rejet du corps : son propre corps dont on n’écoute plus les signaux (ou, en l’occurrence, l’absence de signaux, puisqu’on nous dit que l’on peut être malade sans l’être apparemment, car, c’est bien connu, la guerre c’est la paix, si bien que la santé n’est rien d’autre que la maladie, et bientôt le travail nous rendra libre, peut-être?), rejet du corps de l’autre, cet ennemi potentiel qui peut causer notre mort, rejet enfin de la venue de Dieu dans notre condition humaine. Devons-nous accepter cela? Devons-nous nous parler exclusivement par ordinateurs interposés? A quand le transfert de conscience sur un disque dur ou une clé USB? Le jeune prêtre me répond prudemment que saint Paul a dit de respecter les lois du pays où l’on se trouve. Soit. Mais je ne suis pas convaincue. J’avance l’argument du totalitarisme. J’avance la différence entre légalité et légitimité. J’avance les chiffres de l’épidémie, sans aucun rapport avec ces mesures délirantes. Finalement, il convient que j’ai raison. Nous sommes à une époque de persécution semblable à celle des premiers chrétiens. Tout passera, me dit-il. Cette persécution aussi passera. Ce qu’il faut faire, c’est d’essayer de vivre cela comme le Christ lui-même l’aurait vécue. Continuer de témoigner. Continuer de révéler aux autres le sens de cette épreuve. Que LE CONTACT entre les hommes est ce qu’il y a de plus précieux, et non cette hypothétique « santé » dont le sens exact nous échappe de plus en plus. Je quitte le confessionnal sans m’être confessée et sans être tout à fait soulagée par les paroles du prêtre. Mon sentiment de révolte n’est pas apaisé.
La vie sans contact, c’est les larmes garanties.
Une Française en Italie.