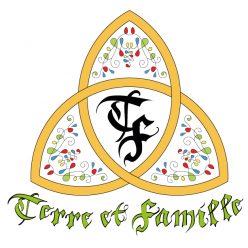Auteur : SBignon
L’Abbé : « La vaccination finale est liée par une « chaîne du mal » à laquelle on ne doit absolument pas participer »
Les variants viennent des vaccinations
Nos églises

Une église est un vaisseau dont le capitaine est le prêtre, tourné vers le levant, vers la lumière, il guide son équipage de fidèles.
Une église est comme une poule. De son long coup elle appelle ses petits à venir reprendre des forces sous ses ailes protectrices.
Une église est une maison construite à l’image de la Sainte Vierge pour contenir le Saint Sacrement, le protéger, l’honorer, l’adorer. Elle est le tabernacle du tabernacle, tout comme Notre Dame est le tabernacle de ses entrailles.
Par amour maternel elle nous appelle de toutes ses forces, de toutes ses cloches à venir chercher le salut éternel sous son blanc manteau, sous ses rassurantes arches de pierres. En pénétrant dans ce sanctuaire, nous pénétrons dans le tabernacle du tabernacle, nous sommes contenus, nous réalisons que nous sommes tous une petite part du corps du Christ, Alléluia !

Pourtant, nos églises brûlent, elles sont vandalisées par ceux qui n’ont pas eu la chance d’en comprendre les grâces. Mais pire encore, elles sont fermées par certains catholiques !? Qui, en tant que catholique, a le toupet de fermer l’accès d’une église aux fidèles ? Qui peut séquestrer le Saint Sacrement, le retenir en otage, qui peut priver Dieu de recevoir et les fidèles d’être reçus par Lui ?
L’humanité est bien fatiguée, elle ne discerne plus le bien du mal, le vrai du faux, le bienséant du ridicule. En un mot et plus que jamais, nos églises doivent être ouvertes ! Elles doivent en ces temps difficiles pouvoir nous armer et nous apaiser spirituellement. Les fermer pour les protéger… la bonne blague ! Qui peut croire à ces balivernes ? Sous couvert de protection tout est enfermé sous clef ou derrière des vitrines. L’admiration de toutes les œuvres de notre belle civilisation chrétienne qui était gratuitement accessible dans nos églises devient payante. Il faut payer pour tout même pour admirer et pendant ce temps les fidèles restent à l’extérieur des églises et les incendiaires courent toujours.
En tant que catholique fermer une église jour et nuit est un acte grave, un acte de trahison à l’égard de Dieu et un acte de mépris à l’égard de son prochain. Ceux qui s’adonnent à ce petit jeu malsain devront un jour rendre des comptes.
Stéphanie Bignon
La supercherie du Covid dévoilée
Protéine Spike, arme de destruction massive ?
Lundi 3 mai : De la férie

| Qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs demeurent fixés là où sont les joies véritables. Tiré de la liturgie du jour. |
| L’agneau pascal |
| Le symbole de l’agneau pour Pâques nous vient de l’Ancien Testament. Au moment de quitter la captivité de l’Egypte, Dieu avait demandé que les Hébreux prennent un repas en habit de voyage et mangent un agneau par famille. On ne devait briser aucun os de cet agneau, et son sang devait être répandu sur les montants des portes pour protéger de l’ange exterminateur… La fête de Pâques, avec le repas pascal, était alors devenue la principale fête de la liturgie juive. Quand saint Jean-Baptiste désignera Jésus comme l’Agneau de Dieu, celui qui vient enlever les péchés du monde, il indiquait que l’agneau du repas était un symbole de Jésus Lui-même, qui serait sacrifié sans que ses os soient brisés, pour sauver les hommes. Le livre de l’Apocalypse désigne 28 fois Jésus glorieux dans le Ciel sous le titre de l’Agneau, ainsi il est devenu naturellement un symbole du Seigneur ressuscité dés l’art primitif et plus particulièrement au haut moyen-âge. Aujourd’hui encore, il est de coutume de manger, à Pâques, de l’agneau rôti ou en gâteau. Si l’on ajoute à ce qui précède, que l’agneau est un animal particulièrement doux qui n’oppose pas de résistance à celui qui le persécute, comment ne pas veiller particulièrement à la douceur en ce temps de Pâques ? |
| Pratique : la douceur pour ceux avec qui nous vivons |
Abbé Henri Forestier
Alertes sur les potentialités toxiques de la protéine Spike
Regard monastique sur le gel
L’eau bénite : un puissant secours pour les âmes du Purgatoire
L’eau bénite, quand on en fait usage avec foi et confiance, est de la plus grande efficacité pour le corps et pour l’âme et peut merveilleusement venir en aide aux âmes du purgatoire.
Chaque fois que le prêtre bénit l’eau pour en faire de l’eau bénite, il agit en qualité de représentant de l’Église dont le Sauveur accueille toujours les prières avec complaisance, quel que soit celui pour qui l’Église lui adresse des prières.
Par conséquent, celui qui prend de l’eau bénite et s’asperge lui-même ou asperge d’autres objets présents ou absents peut être assuré que chaque fois la prière de l’Église montera vers le Ciel et attirera des grâces sur son corps, sur son âme, sur tous les objets touchés par l’eau bénite.
Elle met en déroute la puissance des mauvais esprits. D’où le proverbe : « Il a peur de ceci ou de cela… comme le diable de l’eau bénite ». C’est par millions que l’on pourrait énumérer les exemples qui prouvent de quelle indicible frayeur, l’eau bénite remplit le démon.
Mais comment se fait-il que l’on puisse donner de l’eau bénite à des personnes éloignées et aux âmes du purgatoire, et qu’ainsi on leur vienne en aide ?
Ce que nous avons dit plus haut l’explique. Chaque fois que vous donnez de l’eau bénite à un enfant éloigné ou à un frère, la prière de l’Église qui y est attachée monte vers le Cœur de Jésus et l’engage à prendre sous sa protection vos parents, corps et âme. Il en est de même quand on jette de l’eau bénite aux pauvres âmes du purgatoire. Oh! qui dira tout le soulagement qu’une seule goutte d’eau pourrait apporter aux âmes qui souffrent dans les flammes.
Le Vénérable Dominique de Jésus, conformément à un usage dans l’ordre des Carmes, avait une tête de mort sur sa table. Un jour que le Vénérable lui avait jeté de l’eau bénite, cette tête se mit à parler et cria : « Encore plus, encore plus d’eau bénite! » C’est que, ajouta-t-il, l’eau bénite éteint les flammes de ce feu crucifiant. Oui, une goutte d’eau bénite est certainement souvent d’une plus grande efficacité qu’une longue prière parce que, hélas! notre prière est trop fréquemment tiède et pleine de distractions. Il en est tout autrement de la prière de l’Église attachée à l’eau bénite. Cette prière-là plaît au divin Sauveur, à chaque instant, en tout lieu et partout, chaque fois qu’elle lui est offerte, où que ce soit, par qui que ce soit. Voilà pourquoi les saintes âmes soupirent si fort après l’eau bénite, et si nous pouvions voir de quel tourment elles sont torturées, si nous pouvions percevoir leur instante supplication : « Donnez-nous une goutte d’eau bénite », il n’est pas douteux que nous tâcherions au moins le matin et le soir, et plus souvent pendant le jour, de jeter de l’eau bénite aux âmes du purgatoire.
Combien de fois ne devez-vous pas entrer et sortir! Que de courses dans une journée! Serait-ce donc pour vous un grand effort que de jeter une goutte d’eau bénite dans le purgatoire chaque fois que vous quittez la chambre?
 Quelle joie ne procureriez-vous pas aux âmes? Quel service ne vous rendriez-vous pas à vous-mêmes et aux vôtres en le faisant ! Car les âmes du purgatoire ne sont pas des ingrates! Au moment même où vous leur rendez un service, elles lèvent leurs mains vers le Ciel et prient pour leurs bienfaiteurs avec une ferveur que les plus saintes créatures de la terre ne pourront jamais atteindre. Et Dieu écoute leurs prières avec autant de plaisir que celles que lui adressent ses plus pures épouses d’ici-bas, et Il envoie, dans les plus larges mesures, ses dons et ses grâces à ceux qui leur viennent en aide.
Quelle joie ne procureriez-vous pas aux âmes? Quel service ne vous rendriez-vous pas à vous-mêmes et aux vôtres en le faisant ! Car les âmes du purgatoire ne sont pas des ingrates! Au moment même où vous leur rendez un service, elles lèvent leurs mains vers le Ciel et prient pour leurs bienfaiteurs avec une ferveur que les plus saintes créatures de la terre ne pourront jamais atteindre. Et Dieu écoute leurs prières avec autant de plaisir que celles que lui adressent ses plus pures épouses d’ici-bas, et Il envoie, dans les plus larges mesures, ses dons et ses grâces à ceux qui leur viennent en aide.
Non, un chrétien ne devrait jamais quitter sa chambre sans donner trois gouttes d’eau bénite : une pour lui et pour les siens afin que Dieu les garde de tous dommages de l’âme et du corps; une deuxième pour les mourants, surtout pour les pécheurs mourants, afin que Dieu leur accorde encore, à la dernière heure, la grâce et la conversion; et la troisième pour les âmes du purgatoire.
Oh! que de bénédictions et de garanties de salut, que de mérites et de grâces ne gagneriez-vous pas au cours de l’année pour vous, les vôtres et pour des hommes sans nombre, si vous vouliez pratiquer ce simple petit exercice de charité, sans compter que vous vous assureriez une foule d’intercesseurs dans la vie, à la mort et pour le purgatoire!
Si on savait que, à quelques heures de son pays, demeure un médecin qui fournit gratuitement la médecine, une médecine qui a déjà guéri un nombre infini de malades, mais qu’il faut aller chercher tous les huit jours chez ce médecin, quel empressement ne mettraient pas les gens à faire cette démarche? Croyez-moi, une médecine excellente, c’est l’eau bénite : des milliers ont déjà été guéris en s’en servant avec foi et l’accompagnant de prières, et ont éloigné le malheur de leur maison, de leur étable et de leurs champs.
Chaque jour, notre âme est exposée à des dangers de se perdre… nous avons donc besoin de grâces et de secours. Un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de repousser les assauts de l’ennemi, c’est l’usage pieux de l’eau bénite. Toutes les fois que nous nous en servons, le Sauveur envoie secours, consolation et force pour que nous puissions faire le bien et éviter le mal.
Si vous entendiez sonner le tocsin et crier au feu, vraiment, vous partiriez à toutes jambes, pour procurer au plus tôt tout ce qui peut servir à éteindre l’incendie. Mais voilà, vous n’êtes pas assez fermement convaincus qu’au purgatoire brûle un feu d’une incroyable violence et que des millions et des millions d’âmes sont exposées si longtemps à ce feu effroyable! Eh bien! presque sans peine ni effort, nous pouvons venir en aide aux âmes dans les flammes, une goutte d’eau bénite est d’une si grande efficacité, et nous serions assez paresseux pour reculer devant cet effort? ♦
IMPRIMATUR :E.Touze, vic. Gén.
Source: http://www.revueenroute.jeminforme.org/eau_benite_puissant_secours_pour_ames_purgatoire.php