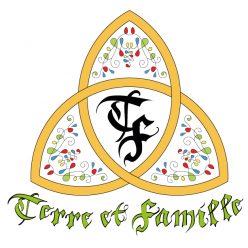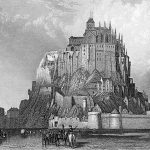« Les vérités ont été diminuées par les enfants des hommes » (Ps. XI, 1)
« On voudrait dans l’immédiat que je sois un saint mais je suis, mes amis, un homme » nous déclarait récemment un présidentiable contraint de reconnaitre qu’il n’était pas aussi impeccable que le prétendait son service de communication. Cela ne le dissuadait pas pour autant de briguer les plus hautes fonctions d’une France dont il a contribué à l’asservissement, comme bien d’autres il est vrai.
Quoi qu’il en soit, cette dichotomie opposant sainteté et humanité, et non pas sainteté et péché, a de quoi surprendre dans la bouche d’un « catholique affiché ». La sainteté serait-elle incompatible avec la nature humaine ? Ou entendrait-on que la sainteté serait destinée aux consacrés, à une élite de fidèles, mais serait inaccessible, si ce n’est nuisible, aux hommes d’Etat ? « Il faut arrêter de penser que les hommes politiques doivent être des saints. C’est une hypocrisie ! », nous assénait en ce sens l’un des plus fervents soutiens dudit candidat, catholique lui aussi. Que les politiciens, exposés à de continuelles tentations, ne soient pas des saints, c’est ce que l’on peut d’autant plus craindre qu’ils se tiennent éloignés des sacrements. Mais que les hommes politiques n’aient pas à être saints, qu’ils n’aspirent pas à l’être, pas même ceux affichant leurs « valeurs chrétiennes » en période électorale, révèle à quel point la confusion voire le cynisme règnent dans le milieu politique français comme dans une grande part de la population.
« Sauvez-moi, Seigneur, car il n’y a plus de saint, parce que les vérités ont été diminuées par les enfants des hommes » (Ps. XI, 1).
Telle est donc l’origine du mal : l’affadissement doctrinal des « enfants des hommes » dont la compagnie est pourtant le délice de la Sagesse éternelle (Prov., VIII, 31). Et en effet, nombre d’entre nous ont oublié la sainteté dans laquelle furent créés nos premiers parents. Ils se sont accoutumés à la déchéance de notre nature au point de la considérer comme originelle. La sainteté n’est plus pour eux la perfection surnaturelle à laquelle Dieu ne cesse de nous convier : c’est au mieux une dangereuse illusion ; au pire, l’obstacle révoltant à un libre épanouissement dans l’hédonisme le plus effréné.
Renonçant de facto au Ciel dont le Paradis terrestre n’était que les prémices, ils n’aspirent plus guère qu’à vivre le plus longtemps possible en ce monde, libérés au mieux de ses souffrances et de ses imperfections : un bonheur prolongé et naturel (et non plus éternel et surnaturel). S’ils croyaient encore à l’éternité, ils troqueraient volontiers le Paradis céleste pour les Limbes, une ineffable intimité avec Dieu pour une « béatitude à échelle humaine » que la sensualité de l' »Eden musulman » ne tarderait pas à concurrencer.
Exagérant enfin l’autonomie de leur existence, qui ne cesse pourtant de dépendre de l’influx divin, ils en viennent à se croire dignes d’amour par eux-mêmes, et non plus comme objet de l’amour de Dieu, au titre de la création et plus encore de la rédemption (« Vous avez été rachetés à un grand prix », 1Co VI, 20). Coupée de ses fondements religieux, la dignité humaine se voit ainsi réduite à une dimension naturelle, « anthropologique », de plus en plus difficile à défendre : l’atteinte à la vie humaine n’est plus un « crime contre Dieu » (Dr Xavier Dor) mais contre l’homme, un homme « libéré » de sa condition de créature pour être au final souvent assimilé à un animal voire à un amas de cellules.
Faut-il dès lors s’étonner que dans ce monde privé du Dieu de Vérité, d’Amour et de Vie, le relativisme, la duperie, la haine de soi et de l’autre soient devenus la règle générale ? Le monde politique n’est que le reflet de notre société et nous avons les gouvernants que nous méritons, qu’ils soient laïques ou ecclésiastiques. Malheureusement, beaucoup trop de catholiques, sous couvert de « réalisme », en viennent à taire qu’ils sont enfants de Dieu, compromettant leur sanctification et la réforme vertueuse des institutions.
« Chacun d’eux a proféré des choses vaines à son prochain, leurs langues sont trompeuses, et ils ont parlé avec un coeur double » (Ps. XI, 2).
Reléguant leur foi dans la sphère privée, les uns prônent une France « laïque et républicaine » comme si le catholicisme pouvait être contraire au bien commun. Ils invoquent les « racines chrétiennes de la France » et célèbrent indifféremment les cathédrales et les sans-culottes, sainte Jeanne d’Arc et Robespierre. Les autres conçoivent des « points non-négociables » de façon restrictive (vie, famille, école) voire modulable selon les opportunités politiques. Ainsi peuvent-ils manifester en nombre pour la défense de la famille et passer sous silence la question de l’avortement ; défendre la vie mais uniquement sur des fondements naturels et dans des structures « aconfessionnelles ». De même, un politicien supposé pratiquant et défavorable au « mariage pour tous », pourra présider le Bilderberg ou spéculer sur les terres agricoles, comme si l’oppression des pauvres et le refus du juste salaire de l’ouvrier ne criaient plus vengeance devant la face de Dieu. D’autres encore, opposés à l’avortement sur le plan personnel, pourront en soutenir publiquement l’extension voire la « sanctuarisation » sans que leur éventuelle excommunication ne soit sérieusement évoquée, ni que le soutien des catholiques ne leur soit officiellement refusé.
Ce triste constat de l’incohérence de beaucoup de catholiques en politique nous ramène, au-delà des défaillances individuelles, à la perversité de notre démocratie que l’on a pu qualifier de « concurrence des démagogies » (Marcel Gauchet). Bien des élus, républicains convaincus, déplorent de plus en plus ouvertement l’impossibilité de défendre un programme fidèle à leurs convictions profondes. Tôt ou tard, il leur faut choisir entre ces dernières et la victoire électorale. De même, beaucoup d’électeurs optent pour le « vote utile » ou « le moindre mal », quitte à renier en pratique leur foi, avec ces mêmes bonnes intentions qui font le pavement de l’Enfer.
« Il en est, et en grand nombre, Nous ne l’ignorons pas, qui, poussés par l’amour de la paix, c’est-à-dire de la tranquillité de l’ordre, s’associent et se groupent pour former ce qu’ils appellent le parti de l’ordre. Hélas ! vaines espérances, peines perdues ! De partis d’ordre capables de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses, il n’y en a qu’un : le parti de Dieu. C’est donc celui-là qu’il nous faut promouvoir ; c’est à lui qu’il nous faut amener le plus d’adhérents possible, pour peu que nous ayons à coeur la sécurité publique. (…) Toutefois, pour que le résultat réponde à Nos voeux, il faut, par tous les moyens et au prix de tous les efforts, déraciner entièrement cette monstrueuse et détestable iniquité propre au temps où nous vivons et par laquelle l’homme se substitue à Dieu ; rétablir dans leur ancienne dignité les lois très saintes et les conseils de l’Evangile ; proclamer hautement les vérités enseignées par l’Eglise sur la sainteté du mariage, sur l’éducation de l’enfance, sur la possession et l’usage des biens temporels, sur les devoirs de ceux qui administrent la chose publique ; rétablir enfin le juste équilibre entre les diverses classes de la société selon les lois et les institutions chrétiennes ».
(Saint Pie X, Encyclique E Supremi, 4 octobre 1903)
L’abbé
 Gabriel García Moreno
Gabriel García Moreno
Homme d’État catholique. Il consacra l’Equateur au Sacré-Cœur en 1873